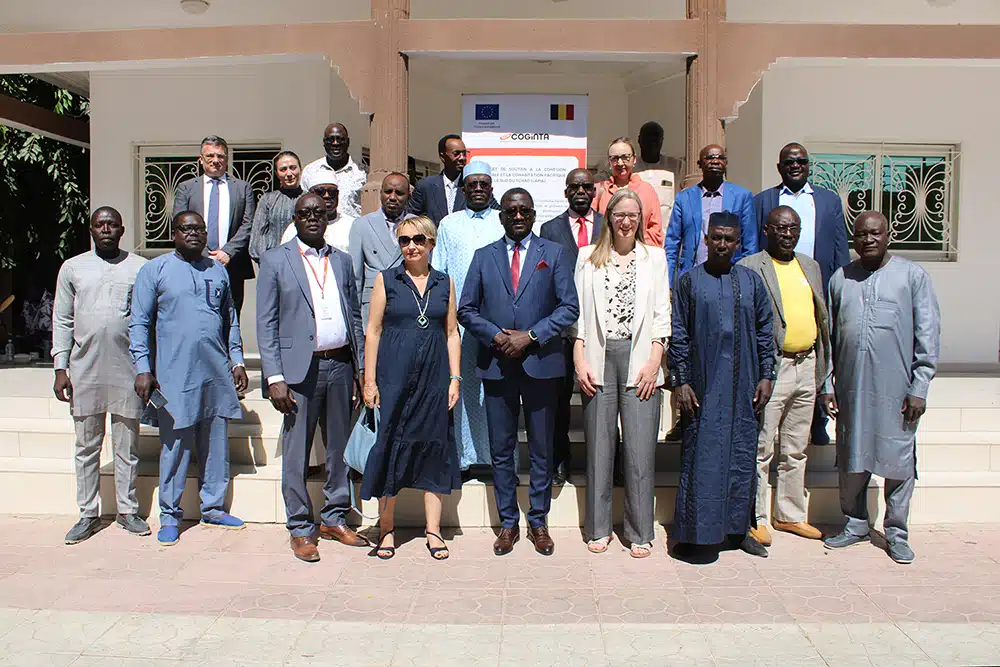Actualités

Tchad : Des résultats significatifs pour la première année du projet LAPIA
Le projet de soutien à la cohésion sociale et la cohabitation pacifique au sud du Tchad (LAPIA) a tenu, du 11 au 12 novembre 2025 à N’Djamena, son deuxième comité de pilotage. Cette rencontre avait pour objectif de présenter les résultats obtenus au cours de la première année de mise en œuvre du projet.
La réunion a été présidée par le Secrétaire permanent des ONG et des Affaires humanitaires du ministère de l’Économie et du Plan, en présence de la cheffe d’équipe de la Délégation de l’Union européenne au Tchad. Pas moins de six préfets et un chef de canton des départements concernés avaient fait le déplacement depuis la pointe sud du Tchad, à plus de 500km de la capitale N’Djamena, pour des débats animés avec les représentants des ministères sectoriels impliqués (administration du territoire, justice et droits humains, environnement, action sociale) et des représentants de la société civile.
Le projet LAPIA, financé par l’Union européenne, avec un soutien financier additionnel de l’État de Genève, a été conçu pour répondre de manière durable aux conflits meurtriers que connaissent les provinces du Logone Oriental, du Mandoul et du Moyen-Chari au sud du Tchad. Ces conflits, qui opposent principalement des agriculteurs et des éleveurs, se soldent par des dizaines de morts, des pillages, des destructions de champs et de propriétés, et des déplacements parfois massifs de populations. Ces cycles de violence s’intensifient par l’usage croissant d’armes à feu, et mettent en péril la sécurité alimentaire et le développement humain dans ces régions.
Le projet LAPIA a enregistré des résultats significatifs depuis son démarrage en novembre 2024. Une étude sur la typologie et la dynamique des conflits dans la zone du projet a été réalisée par le Centre de Recherches en Anthropologie et Sciences Humaines (CRASH), qui apporte un éclairage nouveau sur les dynamiques complexes générant des conflits agro-pastoraux. Sur la base de cette étude, Coginta et ses partenaires locaux Caritas-Goré, ARED et RESAP-MC ont appuyé l’élaboration de feuilles de route provinciales, sous la direction des autorités locales, afin d’imaginer des faisceaux d’actions ciblées susceptibles de renverser cette tendance. Deux mécanismes en particulier renforcent la résilience des communautés à ces conflits : des comités d’entente et de gestion des conflits au niveau des cantons (unité de gouvernance traditionnelle), et des conventions locales de partage des ressources naturelles.
Le projet a déjà renforcé 16 comités existants et créé deux nouveaux comités dans les 18 cantons couverts, et a appuyé de nombreuses actions de communication et de sensibilisation, notamment des émissions radiophoniques, la célébration des Journées de la paix et l’organisation d’une caravane de la paix. Un inventaire des conventions existantes mais souvent méconnues a également été réalisé, ainsi qu’un inventaire des ressources naturelles (couloirs de transhumance, forêts communautaires, bassins halieutiques) pour lesquelles des conventions permettraient d’éviter des conflits. Ces conventions feront l’objet d’une attention particulière durant la deuxième année du projet.
S’il est encore tôt pour mesurer l’impact du projet, les préfets et partenaires ont néanmoins déjà fait part de retours positifs lors du comité de pilotage. Ils apprécient notamment le travail des comités mixtes de dialogue, leur mettant au besoin à disposition des gendarmes pour leur permettre d’intervenir dans de meilleures conditions. Les actions de sensibilisation commencent à porter leurs fruits, diminuant les tensions notamment dans le département des Monts de Lam. Enfin, jeunes éleveurs et agriculteurs sont amenés à se mélanger au cours de célébrations, participant ensemble à des matchs de football ou des danses traditionnelles. Aux dires des partenaires, « ce sont des choses qui ne s’étaient jamais produites ».